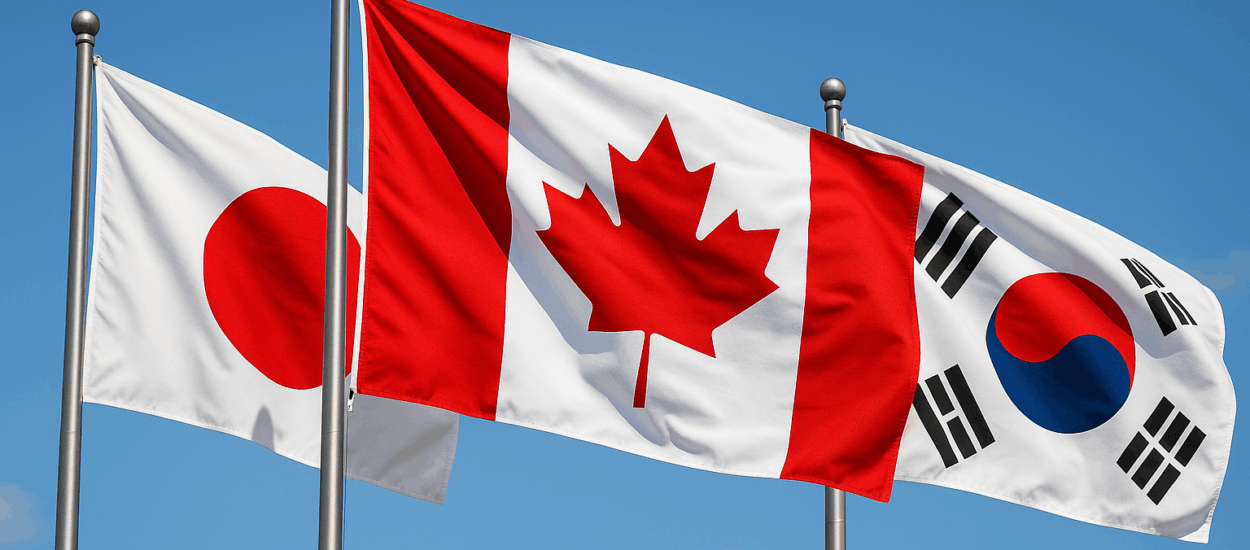L’Indopacifique entre dans une nouvelle phase, portée par un renouvellement des leaderships politiques, une intensification des menaces sur le plan économique et militaire ainsi qu’un resserrement des alliances entre démocraties.
De par sa définition géographique allant des côtes est africaines aux côtes ouest américaines, l’Indopacifique est de fait l’une des zones les plus stratégiques sur le plan géopolitique, commerciale, technologique et militaire.
Le nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba a l’ambition de renforcer la posture géopolitique du Japon en Asie. En Corée du Sud, le nouveau dirigeant Lee Jae-myung – successeur de l’ancien Président Yoon Suk-yeol -, poursuit les coopérations sécuritaires et technologiques avec les partenaires occidentaux. Au Canada, le Premier ministre Mark Carney opte pour la continuité de la stratégie Indopacifique initiée durant l’ère Trudeau.
Alors qu’Ottawa, Tokyo et Séoul intensifient leurs relations, la France reste à l’écart d’une dynamique à laquelle elle pourrait prendre part.
Des partenariats stratégiques
Ces partenariats s’intensifient dans des secteurs stratégiques clés comme l’énergie où l’entreprise japonaise Mitsubishi a investi près de 6,2 milliards de dollars canadiens dans le projet LNG Canada en Colombie-Britannique. D’une longueur de 670 kilomètres, ce gazoduc transporte du gaz naturel liquide (GNL) destiné à l’exportation, notamment vers l’Asie. D’autres grands groupes comme Petronas (Malaisie) ou PetroChina (Chine) sont également inclus dans ce projet.
Sur le plan scientifique et technologique, le Canada et la Corée du Sud développent des projets conjoints autour de l’intelligence artificielle comme le souligne le premier dialogue Canada-République de Corée du volet 1.5 sur les technologies de pointe* qui s’est déroulé le 9 juillet 2025 à Séoul, en Corée du Sud. À l’heure où le domaine de l’IA est dominé par les Etats-Unis et la Chine, cette initiative conjointe vient renforcer la souveraineté technologique d’Ottawa et Séoul.
Les entreprises LG Energy (Corée du Sud) et Panasonic (Japon) investissent stratégiquement au Canada dans des usines de batteries. Ces dernières sont précieuses pour la confection de véhicules électriques, secteur clé en Asie. Dans le même temps, le Canada facilite l’accès aux ressources critiques de ses provinces pour les groupes coréens et japonais. Riche en uranium, la Saskatchewan est une province stratégique au même titre que le Québec et l’Ontario avec le lithium. De son côté, le Manitoba est une province reconnue pour l’exploitation du nickel, du cuivre et du cobalt.
Le projet LNG Canada** et d’autres initiatives s’inscrivent dans le cadre du Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)***. Lancée en 2018, cet accord de libre-échange inédit permet de faire contre-poids aux géants chinois et américains. Le Canada est un membre important au même titre que le Japon, Singapour, l’Australie ou encore la Malaisie. La France n’en fait pas partie, et ce, pour plusieurs raisons.
Premièrement, cet accord concerne les pays géographiquement ancrés en Indopacifique. Puis, l’adhésion au CPTPP est un long processus qui s’étale sur plusieurs années. Enfin, cet accord se veut à l’abri de toute perturbation pouvant être causée par une puissance dominante. C’est pourquoi les candidatures de la Chine et de Taïwan restent en suspens. La seule nation européenne membre est le Royaume-Uni. La France aurait tout intérêt à étudier la question, d’autant plus qu’elle possède une présence Indopacifique grâce à ses territoires ultramarins.
Un positionnement français encore flou, à consolider
La France dispose pourtant d’atouts majeurs : territoires dans la zone, excellence dans l’IA (Mistral AI, INRIA), acteurs énergétiques (EDF, TotalEnergies, Naval Group, Orano). Mais sa stratégie Indopacifique reste peu lisible et souvent diluée dans celle de l’Union Européenne. Ses relations avec Tokyo et Séoul peinent à se traduire en projets d’envergure. Paris, qui entretien de bonnes relations avec le Canada, pourrait jouer un rôle de médiateur dans la crise diplomatique qu’Ottawa et New Delhi traversent depuis octobre 2024.
Cette crise a débuté en 2023 suite à l’assassinat de l’activiste sikh séparatiste Hardeep Singh Nijjar à Surrey (Colombie-Britannique). Il était soupçonné par Ottawa d’avoir été ciblé par des agents gouvernementaux indiens. En octobre 2024, le Canada a accusé six diplomates indiens d’être en lien avec cette affaire (intimidation, extorsion, meurtre) et les a expulsés. L’Inde a riposté en expulsant dans la foulée six diplomates canadiens de son territoire. Depuis, les accords commerciaux bilatéraux ont drastiquement diminué et les relations restent glaciales malgré la participation de l’Inde au G7 2025 au Canada.
Dans ce contexte, la France aurait une chance à saisir. Elle est l’un des rares pays à entretenir des liens solides avec l’ensemble de ces nations. En jouant ce rôle de médiateur, là où Tokyo et Séoul peinent à le faire, Paris pourrait gagner en légitimité et être davantage inclus dans les affaires régionales. Une coopération quadripartite sur l’IA, l’énergie ou les standards technologiques ferait de la France un acteur central.
Le Canada prouve qu’une puissance discrète mais fiable peut structurer des alliances durables en Asie. La France, forte de son potentiel, ne peut plus rester spectatrice. Dans un Indopacifique en constante évolution, l’engagement n’est plus une option, mais une nécessité.